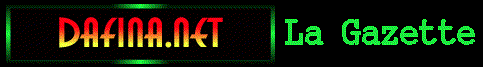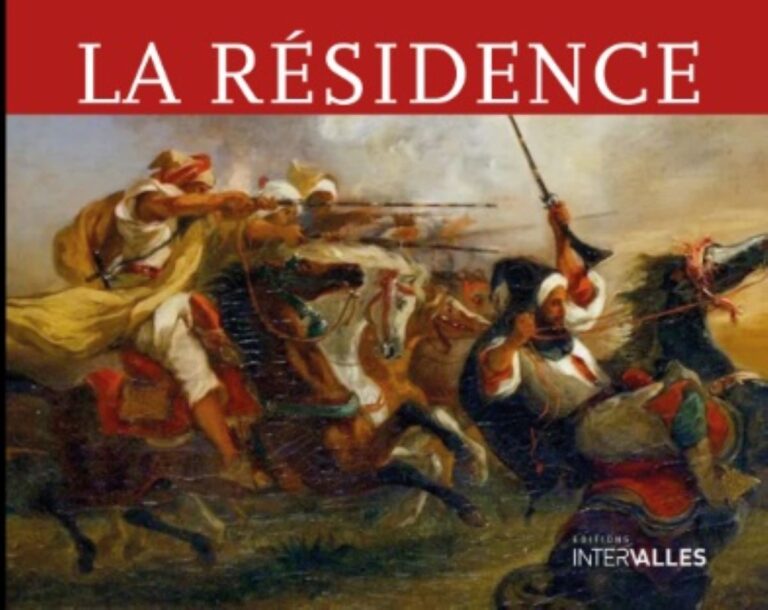«La Résidence» de Laurent Crassat, ou la fabrique intime de l’empire français

«La Résidence» de Laurent Crassat, ou la fabrique intime de l’empire français
Ni roman pur, ni simple essai historique, «La Résidence» explore les conquêtes du Maroc et de l’Algérie à travers les coulisses humaines de l’Histoire. Laurent Crassat y oppose deux modèles coloniaux — l’annexion brutale en Algérie, le protectorat encadré au Maroc — en faisant dialoguer salons feutrés, lettres secrètes, regards d’artistes et décisions d’État. Une fresque où l’alcôve précède le canon, et où la «résidence» devient le symbole d’un pouvoir qui s’installe.
Par Karim Serraj
Dans «La Résidence» (Éditions Intervalles, février 2026), la poudre n’est pas seulement celle des fusils: c’est aussi la poussière du temps, le fard des salons, la cendre des légendes politiques. À mi-chemin de l’essai et du roman, à la fois enquête historique, récit littéraire et réquisitoire philosophique contre une certaine France, la plume de Laurent Crassat plonge dans les coulisses du XIXème siècle, où les destinées individuelles servent de mèches à l’incendie des empires, et raconte la saga des conquêtes du Maroc et de l’Algérie.
Dehors, Paris bascule, le Louvre est pris, Charles X abdique; dedans, un homme «poudré» est cloué au lit: Charles Henri Edgar de Mornay, dandy diplomate qui rate son rendez-vous avec Alger: «Ses bagages sont prêts (…) quand, dans la nuit du 12 juin 1830, une fièvre (…) s’abat sur lui.» La grande Histoire passe devant la fenêtre fermée, rideaux tirés.
Ce n’est que partie remise pour De Mornay. Un an et demi plus tard, muni d’une lettre secrète du roi Louis-Philippe, il est en mission auprès du sultan marocain Abd ar-Rahmân, à Meknès. Il est accompagné de sa maîtresse, Mademoiselle Mars, 52 ans, comédienne au long passé de passions, et d’Eugène Delacroix, amoureux de la belle dame. Déjà, l’Histoire officielle et les passions privées se frôlent, se contaminent, s’éclairent mutuellement.
L’intime comme porte d’entrée de l’Histoire
La force du livre est de présenter la colonisation à travers l’intimité d’acteurs parfois secondaires ou jamais cités dans les livres d’histoire, qui deviennent des personnages romanesques, petits ou grands, jouant un rôle dans l’établissement de la Résidence. Le texte installe ainsi sa méthode à travers une scène creuse comme une chambre, un salon, un voyage et, derrière, survient l’événement public.
Cette alternance devient la cadence même du livre: l’alcôve et l’épopée, le salon et le port, la lettre diplomatique et la rumeur des souks. L’Histoire ne descend pas des manuels; elle monte des corps, des regards, des faiblesses.
Le récit s’étend jusqu’à la guerre du Rif en 1925, en passant par des événements clés comme la prise d’Alger, la guerre de 1870 et les tensions d’Agadir en 1911. Crassat, qui a enseigné au lycée français de Meknès, puise dans son expérience personnelle pour créer une fresque immersive où la mémoire des lieux irrigue la narration. Le Maroc n’est pas un décor plaqué: il est vécu, traversé, intériorisé.
La galerie des figures historiques égrène des noms côté français: Adolphe Thiers, Charles-Maurice de Talleyrand, Thomas Robert Bugeaud, Hubert Lyautey, Jean Jaurès, etc., et côté nord-africain Abdelkader, Abdelkrim el-Khattabi, ainsi que des intellectuels et artistes tels Victor Hugo, Charles Péguy, Eugène Delacroix, et j’en passe. Ces silhouettes ne sont pas des statues: elles respirent, hésitent, manœuvrent.
Le titre, justement, est un piège doux. Une résidence peut être un logement, une résidence secondaire, une résidence d’artistes; mais dans l’histoire impériale, le mot désigne la demeure et donc la présence du pouvoir colonial. Il met en regard deux modèles de domination: la conquête algérienne et le protectorat marocain. Le décor est posé: l’histoire en mouvement, les arts en escorte, et déjà l’ombre d’une administration qui s’installe.
Le Maroc, révélation et mise en scène du pouvoir
Le Maroc occupe une place spéciale dans «La Résidence». C’est un Maroc lumineux, vibrant pour Laurent Crassat, sensuel et sensoriel, épousant la tradition romantique. L’Orient est une révélation. On découvre l’Empire chérifien avec l’œil de Delacroix, que Paris qualifie encore de «terra incognita». Le peintre devient sismographe; le Maroc, tremblement.
Un Delacroix ébloui, qui «n’a jamais contemplé la lumière jusqu’à ce jour» et découvre un pays comme un carnet de gouache ouvert, «à chaque pas (…) il y a des tableaux tout faits». L’écrivain réussit ici quelque chose de rare: l’enthousiasme n’est pas seulement déclaré, il est incarné par la syntaxe elle-même. Les phrases s’emballent, les parfums suintent, les couleurs éclatent. L’écriture reproduit la surabondance du réel. Se promène cette «beauté qui court les rues et vous assassine de sa réalité».
Puis vient l’audience avec le sultan Abd ar-Rahmân. Le rêve rencontre le protocole. La toile change d’angle: surveillance, tension, crainte de la provocation. La scène promet l’exceptionnel, puis se résout en un échange bref, presque administratif. Et soudain: «le silence retombe tout d’un coup sur la place, comme un rideau.»
Ce contraste frappe. Le Maroc rêvé se heurte au Maroc négocié. La lumière laisse place à la géométrie du pouvoir.
L’entrée en scène d’Abraham Benchimol est décisive. Ce juif marocain, passeur culturel et social, ouvre des portes au propre comme au figuré. Grâce à lui, le récit quitte le décor public, les ruelles, cortèges, cérémonies, pour pénétrer l’intime des patios et des salons. Crassat privilégie les émotions aux abstractions. On retrouve ici le style de Crassat qu’on aime, privilégiant les émotions à l’Histoire froide et imperturbable qui tient parfois à une lettre pliée dans de la soie, à trois pas en avant, à un signe de tête et, tout autour, la foule et ses attentes.
Autre réussite: le regard porté sur le décor du pouvoir — faïences, plafonds, cour — mêle admiration et désenchantement. La splendeur cohabite avec l’usure. Rien n’est idéalisé. Cela évite le cliché d’un Orient uniformément fastueux.
L’Algérie, la conquête comme rupture
L’œuvre construit sa tension narrative autour d’un diptyque: deux «visages» de la domination coloniale qui ne se confondent ni dans leurs méthodes ni dans leurs imaginaires.
En Algérie, la conquête est frontale, militaire, brutale. Elle procède d’une logique d’annexion et d’administration directe. Dès 1830, l’entreprise coloniale prend la forme d’une substitution de souveraineté aux Ottomans: l’État français ne se contente pas d’encadrer, il remplace. Mobilité des colonnes, destruction des ressources, domination durable par installation.
Lire aussi : Parution. «France-Algérie, le double aveuglement», ce que révèle le dernier livre de Xavier Driencourt
La prose épouse cette dureté par des phrases martelées, quasi militaires:«Bugeaud a les hommes. / Bugeaud a les canons. / Bugeaud a carte blanche.»
L’armée ouvre la voie. Les terres sont confisquées, redistribuées, cadastrées. Les structures traditionnelles sont disloquées. La colonisation de peuplement installe une présence durable et massive. La domination s’y affiche sans détour: elle occupe, tranche, réorganise, spolie.
Le régime juridique traduit cette violence structurelle: expulsion des Janissaires, statut d’indigénat aux autochtones, hiérarchie raciale inscrite dans le droit, fragmentation des communautés. L’Algérie devient un prolongement du territoire français, divisée en départements, comme si la mer Méditerranée n’était qu’un accident géographique.
La tutelle et la continuité
Au Maroc, le dispositif paraît d’une autre nature. Le protectorat est présenté comme «discret», enveloppé dans le vocabulaire de la réforme et de la modernisation. La souveraineté du sultan est maintenue formellement. Le traité de Fès de 1912 n’abolit pas l’État marocain; il le place sous tutelle. Ce n’est pas une annexion, mais une mise sous contrôle.
Cette nuance ne signifie pas absence de violence. Les résistances armées dans le Rif, au Moyen Atlas ou dans le Sud rappellent que le protectorat ne fut jamais une promenade diplomatique. Mais la stratégie diffère. Au Maroc, l’autorité coloniale s’appuie sur un appareil étatique déjà structuré. Elle compose avec un makhzen ancien, une bureaucratie, une fiscalité, une tradition politique séculaire.
C’est ici que la figure de Hubert Lyautey devient centrale. Il incarne une doctrine coloniale particulière: gouverner sans détruire l’édifice existant, réformer sans humilier ostensiblement, administrer en se présentant comme le garant de la continuité historique. Son projet repose sur une lecture politique du Maroc: un empire chérifien millénaire, doté d’une légitimité religieuse et dynastique, d’un réseau de notables, d’une architecture administrative qu’on ne peut balayer sans provoquer l’effondrement.
L’œuvre montre ainsi que la France ne trouve pas au Maroc un «vide» institutionnel, mais un État ancien, centralisé autour de la figure du sultan, avec ses ministres, ses caïds, ses circuits fiscaux et diplomatiques. Cette présence d’un pouvoir autochtone structuré contraint la stratégie coloniale. Là où l’Algérie est remodelée en profondeur, le Maroc est encadré, reconfiguré, orienté. L’administration française se superpose au makhzen plutôt qu’elle ne l’anéantit.
Deux laboratoires d’une même ambition
Le contraste entre ces deux régimes politiques éclaire la thèse de l’auteur: la domination coloniale n’est pas un bloc homogène. Elle s’adapte aux contextes, aux résistances, aux héritages étatiques. En Algérie, la France construit un territoire colonial comme une extension d’elle-même. Au Maroc, elle gouverne à travers un État préexistant qu’elle ne peut ignorer.
Mais derrière cette distinction stratégique affleure une même logique de contrôle. Discrète ou brutale, la domination vise la maîtrise des territoires, des ressources et des populations. La différence tient à la forme, non au fond.
En juxtaposant ces deux «visages», le texte met en lumière la plasticité de l’entreprise coloniale française. Elle sait se montrer impérieuse lorsqu’elle impose l’annexion; elle sait se dire protectrice lorsqu’elle s’adosse à un État ancien. L’Algérie et le Maroc deviennent ainsi deux laboratoires d’une même ambition impériale, révélant que la colonisation n’est pas seulement une conquête des terres, mais une conquête des formes politiques.
«La Résidence», Laurent Crassat, 157 pages. Éditions Intervalles, 2026. Disponible en précommande dans les librairies.
Par Karim Serraj