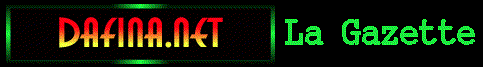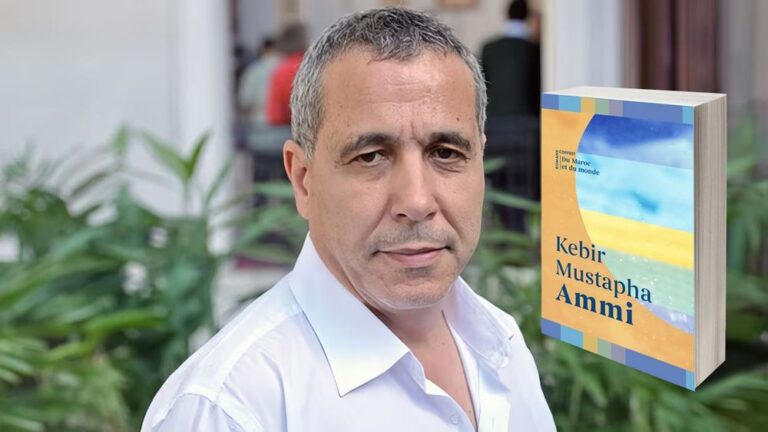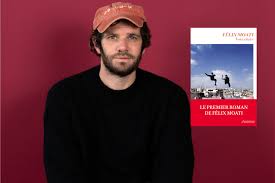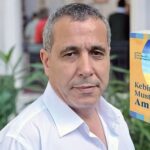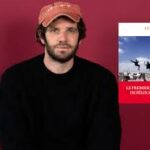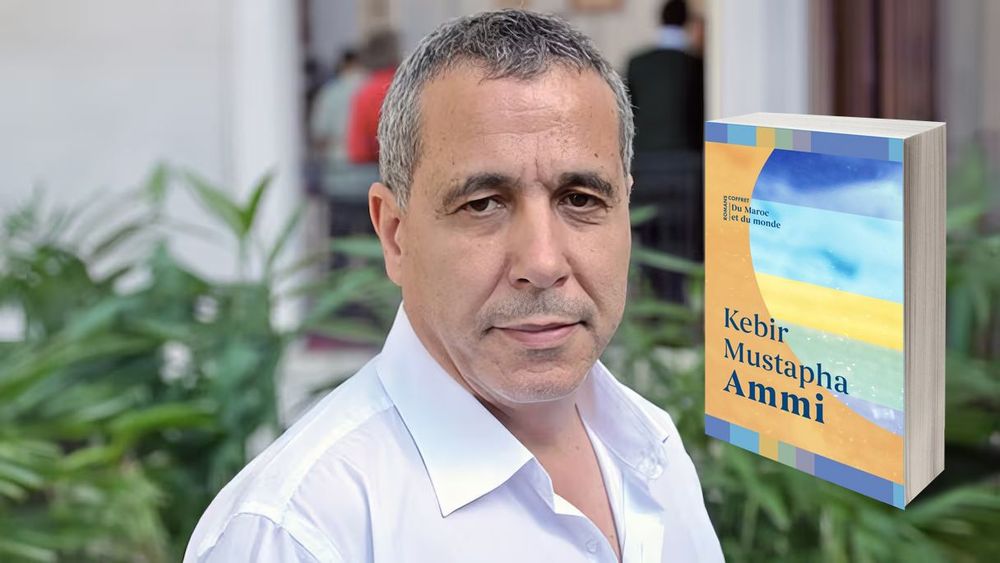Le Maroc : un modèle singulier dans l’espace maghrébin ?

Le Maroc : un modèle singulier dans l’espace maghrébin ?
Par Loubna El Joud
Au sein de l’espace maghrébin, le Maroc occupe une place particulière dans la manière dont il a intégré la mémoire juive à son récit national. Ce que l’on désigne souvent comme « l’exception marocaine » ne relève pas d’un mythe, mais d’un choix politique et culturel affirmé.
Contrairement à l’Algérie ou à la Tunisie, où les communautés juives ont été largement assimilées, puis effacées du récit postcolonial, le Maroc a maintenu des liens forts avec sa diaspora juive. Dès l’indépendance, une volonté d’inclure cette mémoire a été portée au plus haut niveau de l’État. Cette orientation s’est traduite non seulement par des discours, mais aussi par des actes concrets : protection des lieux de culte, restauration des synagogues, reconnaissance institutionnelle.
Le choix de la monarchie de reconnaître l'affluent hébraïque" comme partie intégrante de l’identité marocaine — inscrit dans la Constitution de 2011 — marque une rupture avec les récits homogénéisants souvent dominants dans le monde arabe. Le Maroc assume ainsi une conception plurielle de la nation, ancrée dans une histoire de coexistence et de diversité.
Le pluralisme n’est pas qu’un héritage du passé , il se manifeste encore aujourd’hui dans la vitalité des échanges entre le Maroc et sa diaspora juive. Chaque année, des milliers de Marocains de confession juive, établis en France, au Canada, aux États-Unis ou en Israël, reviennent visiter leurs villes natales, participer aux hiloulot ou entretenir les liens familiaux. Cette fidélité témoigne d’un attachement durable.
La politique active de valorisation du patrimoine juif, soutenue par la monarchie et la société civile, renforce cette dynamique. La restauration des anciens mellahs, la préservation des cimetières, les initiatives éducatives contribuent à maintenir vivante cette mémoire. Elle n’est pas réduite à un folklore, mais intégrée à la construction d’une identité nationale ouverte.
Ce positionnement du Maroc intervient dans un contexte régional marqué par des tensions identitaires et des conflits géopolitiques.
Alors que certains pays se replient sur des définitions exclusives de leur identité, le Maroc affirme une vision souveraine, fondée sur l’inclusion. Ce choix n’est pas sans défis : il exige une vigilance constante face aux courants extrémistes et aux idéologies importées.
Il serait illusoire de présenter le Maroc comme un paradis du vivre-ensemble, car les tensions existent, les contradictions aussi, mais la trajectoire marocaine montre qu’il est possible, dans un cadre musulman majoritaire, de reconnaître pleinement une mémoire juive et de l’inscrire dans le présent.
Cette expérience marocaine, avec ses forces et ses limites, offre des pistes de réflexion pour d’autres contextes.
Le pluralisme marocain repose sur un équilibre dynamique, qui demande à être constamment réaffirmé. Il repose sur une éducation au respect de l’autre, sur une politique de la mémoire rigoureuse, et sur un récit national capable d’assumer ses différentes strates. À l’heure où les crispations identitaires fragilisent les sociétés, ce choix demeure plus que jamais nécessaire