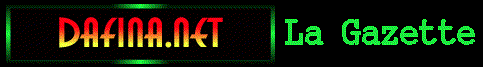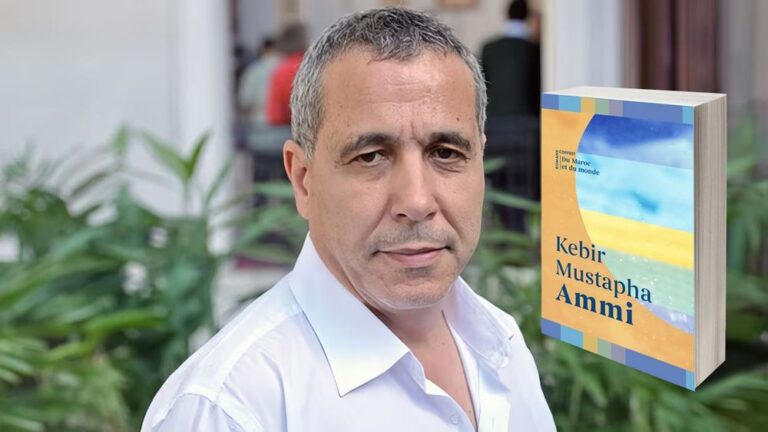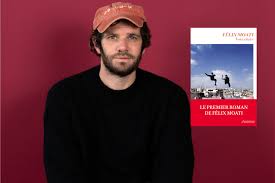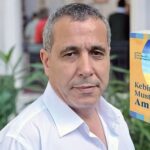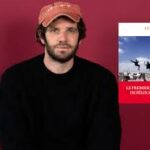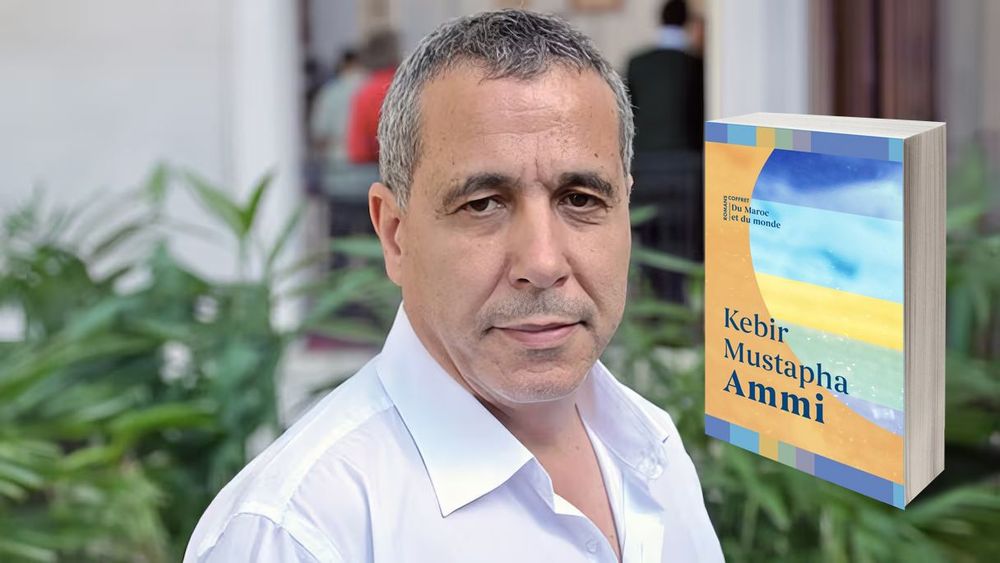L’esprit de Pugwash – David Bensoussan et Samuel S. Kloda

L’esprit de Pugwash – David Bensoussan et Samuel S. Kloda
À l’heure où la planète est engagée dans un processus de réarmement massif et où les craintes de prolifération nucléaire suscitent des inquiétudes existentielles, il est essentiel de revenir sur l’histoire des premières bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que sur l’engagement des scientifiques pour limiter l’usage de ces armes dévastatrices.
David Bensoussan Professeur d’électronique à l’École de technologie supérieure
Samuel S. Kloda Auteur de l’ouvrage The Atomic Bomb in Images and Documents
La découverte de l’uranium par le chimiste allemand Martin Heinrich Klaproth en 1789, suivie des travaux de Marie et Pierre Curie sur le polonium et le radium en 1898, ont ouvert la voie à l’étude de la radioactivité. Quatre ans plus tard, Ernest Rutherford mit en équation le phénomène de désintégration radioactive à l’Université McGill, tandis que le modèle atomique prenait forme grâce aux travaux de Niels Bohr, lauréat du prix Nobel en 1922.
La découverte du neutron par James Chadwick en 1932 fut une percée déterminante qui mena, en 1938, à l’identification de la fission nucléaire par Otto Hahn, Fritz Strassmann et Lise Meitner. La compréhension du mécanisme de la réaction en chaîne, conçue dès 1933 par Leo Szilard, permit d’envisager l’application militaire de cette énergie.
Le projet Manhattan et l’escalade militaire
En 1939, Leo Szilard persuada Albert Einstein de signer une lettre adressée au président Roosevelt, alertant sur le risque que l’Allemagne nazie développe une bombe atomique.
Ce fut le point de départ du projet Manhattan, officiellement lancé en 1942 avec un budget de deux milliards de dollars, rassemblant des milliers de chercheurs, dont Enrico Fermi, Glenn Seaborg et J. Robert Oppenheimer.
Les premières bombes utilisèrent deux technologies : la bombe à uranium « Little Boy », larguée sur Hiroshima, et la bombe à plutonium « Fat Man », utilisée à Nagasaki.
Les décisions lourdes de conséquences
Le 16 juillet 1945 eut lieu le premier essai nucléaire à Alamogordo, au Nouveau-Mexique. L'explosion terrifiante creusa un cratère de plus de 350 mètres de large ; elle fut entendue à des dizaines de kilomètres, et il arriva que des vitres furent brisées jusqu’à 80 kilomètres du site. À ce moment-là, l’Allemagne avait déjà capitulé, mais la guerre contre le Japon se poursuivait. Face à une résistance acharnée des militaires japonais et à la prédiction de pertes humaines américaines estimées à plus d’un demi-million de soldats, le président Truman prit la décision controversée d’utiliser la bombe atomique pour forcer une reddition rapide du Japon.
Le bombardement dévastateur d’Hiroshima (6 août) puis de Nagasaki (9 août) se solda par la mort de près de 230 000 personnes incinérées ou vaporisées. Près de 110 000 autres périrent des suites des radiations. Il précipita la capitulation du Japon le 15 août 1945.
Depuis cette date, 2159 essais nucléaires ont été réalisés, qu’ils soient atmosphériques, souterrains ou sous-marins. Parmi eux figurent des bombes thermonucléaires à hydrogène bien plus puissantes ainsi que des bombes à neutrons, dont les radiations et les effets destructeurs ciblent avant tout les organismes biologiques.
Les réserves des scientifiques et les voix du désarmement
Dès avant les bombardements atomiques, plusieurs scientifiques avaient exprimé leurs réserves, craignant la propagation d’une technologie aux conséquences incalculables et demandant que l’arme atomique soit larguée dans des zones inhabitées à des fins de démonstration seulement. Robert Oppenheimer, chef scientifique du projet Manhattan, avoua plus tard à Truman son profond remords : « Monsieur le président, j’ai l’impression d’avoir du sang sur les mains. » Albert Einstein devint un ardent défenseur du désarmement nucléaire, publiant en 1955 le Manifeste Russell-Einstein qui appelait à la paix et au contrôle des armes atomiques.
Andrei Sakharov, physicien soviétique et père de la bombe H, changea lui aussi de camp dans les années 1960 pour devenir un militant pacifiste et défenseur des droits de la personne, dénonçant les dangers nucléaires.
Le mouvement Pugwash : science et conscience
Né en 1957 à l’initiative de Józef Rotblat et Bertrand Russell, le mouvement Pugwash a évolué dans le contexte tendu de la guerre froide. S’appuyant sur le Manifeste Russell-Einstein, il réunit intellectuels, scientifiques et diplomates soucieux de prévenir la guerre nucléaire et de promouvoir la responsabilité éthique face aux avancées scientifiques.
À travers des rencontres informelles entre experts des deux blocs, Pugwash favorisa un dialogue apaisant et influença la création de traités de désarmement majeurs, notamment le Traité de non-prolifération nucléaire (TNP) et le Traité d’interdiction partielle des essais nucléaires. En 1995, le mouvement reçut le prix Nobel de la paix, saluant son rôle discret mais déterminant dans la promotion de la paix mondiale.
Un esprit toujours d’actualité
L’utopie messianique de paix universelle semble aujourd’hui plus éloignée que jamais. Il n’en demeure pas moins que face aux menaces contemporaines – armes nucléaires renouvelées, réarmement intense, cyberattaques, pandémies et changement climatique –, l’esprit de Pugwash demeure une référence majeure. Il rappelle que la science, déconnectée de l’éthique, peut devenir un pouvoir aveugle. La responsabilité des scientifiques dépasse les laboratoires : elle s’inscrit dans une démarche globale de la paix et de la survie de l’humanité.