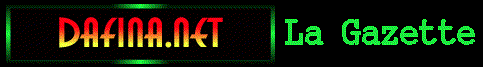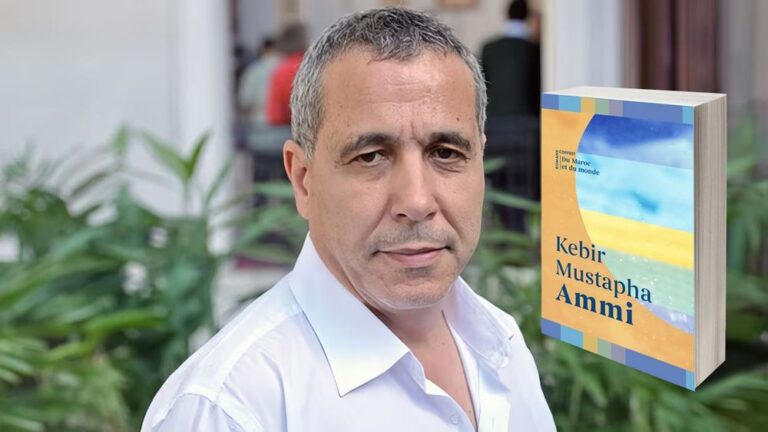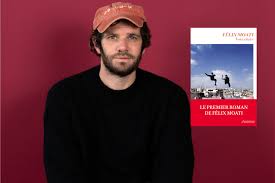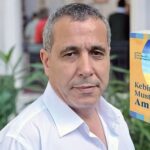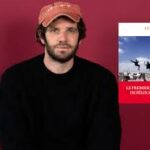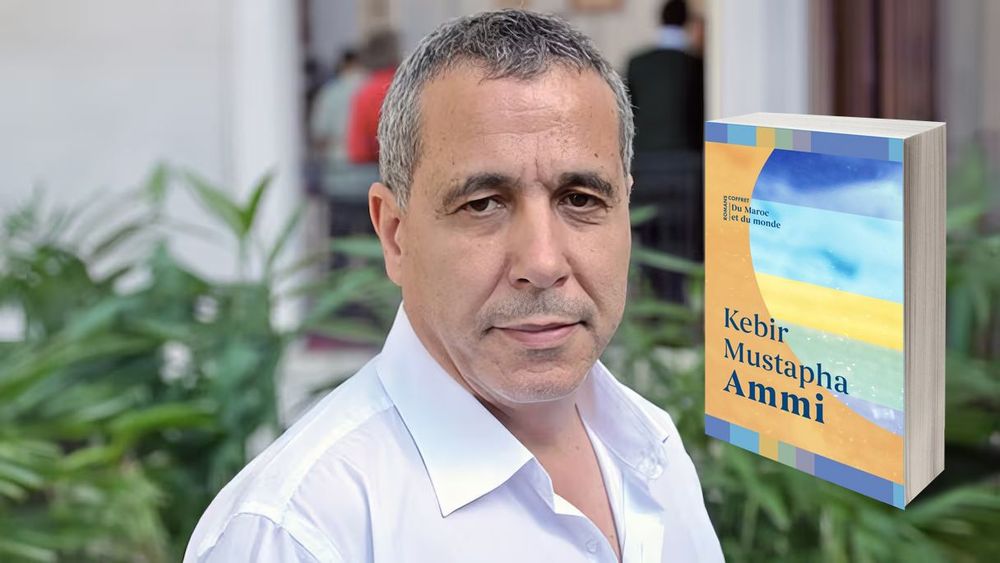Le moi en devenir : science, conscience et intelligence artificielle – David Bensoussan

Le moi en devenir : science, conscience et intelligence artificielle – David Bensoussan
L’auteur est professeur de sciences à l’Université du Québec
Longtemps domaine réservé des philosophes, la conscience fut l’objet d’introspection, de spéculation et de débats sur l’âme, l’esprit et l’identité personnelle. Elle échappait à toute investigation empirique. Ce n’est qu’à l’époque moderne que les physiciens, chimistes, biologistes et théoriciens s’y sont intéressés, espérant percer le mystère de cette expérience intime. Malgré les avancées spectaculaires des neurosciences et de la modélisation cognitive, la conscience demeure une énigme : elle est une expérience subjective, universelle et pourtant insaisissable.
Phénomène paradoxal, la conscience est à la fois ce que chacun expérimente quotidiennement et ce que la science peine encore à expliquer. Elle permet l’intégration du vécu, forge l’identité, et constitue le prisme par lequel le monde prend sens. Peut-on la réduire à des réseaux neuronaux en activité ? N’est-elle que le produit de l’interaction entre le corps et l’esprit ? Résulte-t-elle d’un dialogue constant avec l’environnement ? Ou faut-il envisager une synthèse de ces approches pour en approcher l’essence ?
En parallèle, la science a considérablement levé le voile sur les lois de la nature. En quelques millénaires, l’humanité a vu ses capacités physiques et mentales se multiplier : de la roue à la machine, de l’imprimerie à l’électronique, de la photographie à l’ordinateur, les innovations ont permis de stocker, classer, analyser et agir avec une efficacité croissante. Ces progrès s’accompagnent d’un mouvement d’externalisation toujours plus poussé de la mémoire, de l’analyse et de l’action.
L’intelligence artificielle (IA) marque aujourd’hui une nouvelle étape : celle d’un dialogue avec une machine capable de simuler une forme de compréhension, de produire des réponses, voire d’inventer.
Mais que devient la conscience humaine face à cette nouvelle entité ? Est-elle enrichie, menacée, transformée ? L’IA agit-elle comme un miroir, un amplificateur, ou un substitut ? Nous n’en sommes encore qu’aux balbutiements, et les effets de cette cohabitation restent à découvrir. Il est probable qu’elle redéfinira en profondeur notre rapport au savoir, à la créativité, et à la construction de soi.
C’est dans cette tension entre subjectivité irréductible et externalisation technologique que s’esquisse un « moi en devenir ». Un moi façonné par le corps, l’esprit, l’environnement – et désormais ses extensions cognitives. Un moi que la science éclaire sans jamais en dissiper complètement le mystère.
Qu’est-ce que la conscience ?
La conscience peut se définir comme la capacité de savoir que l’on sait, d’être lucide sur sa propre existence. En énonçant cogito, ergo sum — je pense donc je suis — Descartes affirmait que la conscience de soi constitue une preuve irréfutable de l’être, qui dépasse les perceptions sensibles. Elle implique à la fois la maîtrise du corps, la perception du monde extérieur, et la reconnaissance de soi comme entité distincte dans cet environnement.
Mais en quoi cette conscience se distingue-t-elle de la simple cognition, qui permet de traiter l’information extérieure, ou encore de la sentience, cette aptitude à ressentir sensations et émotions ? Est-elle un phénomène strictement physique, produit par l’activité du cerveau que l’on pourrait détecter par les ondes cérébrales ? Résulte-t-elle d’une interaction entre le corps et une entité immatérielle que l’on pourrait nommer « âme » ? S’inscrit-elle dans un dialogue continu avec le milieu ambiant, ou relève-t-elle d’une origine qui transcende l’enveloppe corporelle ?
À cette énigme s’ajoute la multiplicité de ses états : subconscient, inconscient, états modifiés de conscience (méditation, extase mystique, hypnose régressive, rêve), autant de formes qui complexifient encore notre appréhension de ce phénomène intérieur toujours insaisissable. La conscience peut aussi se manifester à travers des registres divers : conscience sensorielle, conscience mentale et abstraite, ou encore états altérés par les substances hallucinogènes.
Par ailleurs, la conscience semble fonctionner sur plusieurs niveaux simultanés : il est, par exemple, possible de conduire tout en tenant une conversation, signe d’une architecture cognitive distribuée. La cognition identifie, classe, donne un nom, des propriétés ou une fonction aux éléments perçus. La logique articule l’intuition avec le réel pour produire une représentation mentale du monde dont l’émergence consciente semble plus lente par rapport à la rapidité vertigineuse avec laquelle les neurones traitent les signaux sensoriels.
La conscience serait-elle le fruit d’un traitement élaboré des données des sens au cerveau ? Il faut retenir que la conscience émerge au sein d’impressions subjectives modulées par l’intégration de plusieurs états physiologiques. L’analyse de l’activité cérébrale dans des états de conscience éveillée, de conscience amoindrie (en état d’ivresse par exemple) ou d’inconscience durant le sommeil n’a pas abouti à des conclusions définitives.
Donner un sens à la réalité observée
Peut-on avancer que la conscience est issue de la poursuite de l’évolution allant de l’hominidé à l’homo habilis, l’homo erectus, l’homme de Neandertal et l’homo sapiens ? Ce dernier aurait fait son apparition il y a près de 120 000 ans. L’instinct de survie, la vie communautaire, le développement d’outils, du langage puis de l’écriture ont contribué à établir l’entendement qui donne un sens à la réalité physique observée.
Au fil des millénaires s’établit une démarche scientifique déterministe pour analyser la réalité observée en recourant à des règles qui portent en elles leur évidence. Mais on ne voulut plus se contenter de ce que la science se limite à un pur calcul prédictif ; on visa aussi à comprendre le réel, à donner du sens aux lois qu’elle énonce. Instrument de précision et d’abstraction, le langage mathématique permet de formuler, d’unifier et de prédire les phénomènes physiques.
La conception prédicative de la science se contente de certitudes pratiques et limitées en s’appuyant sur le formalisme mathématique, lequel s’appuie lui-même sur des axiomes. S’interroger sur la légitimité des fondements mathématiques que sont les axiomes revient à interroger la légitimité de tout l’édifice scientifique à moins d’accepter que la démarche mathématique est de nature dialectique.
Idéalement, il faudrait asseoir une doctrine qui satisfasse à la fois mathématiciens, logiciens et philosophes, saisir la nature des relations à concevoir entre le formel et le réel, et plus largement entre le concret et l’abstrait. Une telle doctrine devrait également clarifier les liens que nous établissons entre les jugements d’intuition et la déduction méthodique, ou encore le formalisme mathématique.
Ce dessein semble tenir davantage du rêve que de la réalité…
Considérations neurophysiologiques
Comment les transmissions électrochimiques du cerveau permettent-elles un traitement rapide et adaptatif de l’information sensorielle, cognitive et émotionnelle ainsi que l’émergence de la mémoire, du raisonnement abstrait et de la conscience ?
Comment cerner le fonctionnement global du cerveau ? La recherche contemporaine sur le cerveau s’intéresse aux mécanismes du cerveau – à l’échelle microscopique principalement. La recherche s’appuie sur une approche multidisciplinaire — mêlant biologie moléculaire, neurosciences, imagerie et IA — dans l’espoir de mieux comprendre cet organe complexe et d’améliorer la prévention, le diagnostic et le traitement des troubles neurologiques.
Parmi les nombreux axes de recherche, ceux qui se rapportent un tant soit peu façon à la conscience sont la génétique, le connectome et le vieillissement.
Les avancées en génétique, ont réussi à décrypter le code de notre ADN, c’est-à-dire le plan de fabrication de notre corps. Grâce à cela, les scientifiques peuvent identifier certains gènes qui influencent le fonctionnement du cerveau. En toute probabilité, l’évolution du génome a permis l’émergence de la conscience bien qu’en toute connaissance de cause, celle-ci ne soit pas codée dans le génome.
Le connectome est une autre piste de recherche. L’objectif est de mieux comprendre comment notre cerveau pense, tout en ressentant, en apprenant et en agissant. Le connectome est une sorte de carte géante des connexions entre les milliards de neurones de notre cerveau, en observant comment ces connexions sont organisées, ou comment l’influx nerveux circule dans l’enchevêtrement des neurones.
L’évolution de la conscience peut être pensée comme l’évolution des configurations dynamiques du connectome convergeant en une conscience plus structurée et plus complexifiée.
La recherche s’intéresse de plus en plus au vieillissement du cerveau. Avec l’âge, il est normal que nos facultés diminuent un peu, mais certaines maladies comme Alzheimer accélèrent ce processus. La dégradation biologique associée à la vieillesse peut fragiliser l’état de conscience tout en conservant une certaine lucidité.
Aucune activité neuronale distincte n’a pu être rattachée avec certitude à la conscience elle-même, ni même à la manifestation du libre arbitre précédant une action. Bien qu’il soit possible d’identifier dans le cerveau certaines zones d’activité neuronale distinctes en réponse à des sensations physiologiques (sommeil, rêve, douleur, etc.), les essais cliniques n’ont pas permis de localiser une région cérébrale correspondant de manière univoque à l’état de conscience.
Selon une thèse dite émergentiste, la conscience aurait apparu lorsqu’un seuil de complexité a été dépassé dans le cerveau. C’est la théorie préconisée par Theilhard de Chardin qui considère que l’évolution de l’univers (orthogenèse) s’est faite en plusieurs phases décrites par le monde inerte (géosphère), la phase biologique qui est celle des êtres vivants (biosphère) et la phase d’intelligence et de conscience (noosphère). De fait, le cerveau humain comprend près de 80 milliards de neurones, chacun d’eux étant connecté à 5 000 à 10 000 autres. Mises bout à bout, les connexions neuroniques auraient une longueur équivalente à celle de la distance terre-soleil, soit 150 000 000 de kilomètres.
Se pourrait-il que le cerveau ait des capacités très supérieures par rapport à celles dont il est possible d’être conscient et que l’on ait recours qu’à une faible fraction du potentiel cérébral ? Que ces capacités supérieures mettent en jeu des phénomènes quantiques qui s’imbriquent dans le cerveau ?
Quels phénomènes quantiques peuvent impliquer le cerveau ?
La mécanique quantique a montré que notre compréhension du réel est limitée par nos sens et par nos capacités cognitives. Le monde serait beaucoup plus complexe que ce que nous en percevons et comprenons. Ces dimensions « étranges » ont été mises à jour par la physique quantique. Se pourrait-il que les phénomènes quantiques existent au sein du cerveau ?
La physique quantique aborde les implications ontologiques et philosophiques de la mécanique quantique. Cette dernière élabore le formalisme conçu pour modéliser mathématiquement le comportement des systèmes microscopiques (atomes, particules, etc.). C’est un cadre rigoureux permettant de calculer et de prédire les résultats expérimentaux, fussent-ils formulés sous forme probabiliste. Par contre, la physique désigne un champ plus vaste qui englobe la mécanique quantique, mais s’intéresse aussi aux questions d’interprétation, de signification et de fondements. Or, contrairement à la physique classique, il n’existe pas d’image intuitive ou univoque du monde que la physique quantique décrit.
Les particules quantiques (de l’ordre du nanomètre) ont des propriétés contextuelles qui dépendent de facteurs extérieurs. Elles n’ont pas des propriétés intrinsèques, car celles-ci sont fonction des circonstances qui permettent de les déterminer, tout comme la mesure. Y a t-t-il une corrélation entre les comportements particuliers exhibés par les particules quantiques et l’état de conscience ?
La mécanique quantique repose sur des lois probabilistes, contrairement au déterminisme spatial et temporel de la physique classique. Ce caractère non déterministe pourrait-il être mis en parallèle avec le phénomène du libre arbitre, cette capacité à faire des choix, transcendant ainsi les déterminismes neuronaux et environnementaux ?
L’état d’une particule quantique (position, énergie) peut être multiple, mais est déterminé seulement au moment de l’observation. Lorsqu’on l’observe, elle « choisit » un état. Peut-on comparer cela au fait que notre conscience joue un rôle dans la façon dont nous vivons ou décidons une situation ? Peut-on extrapoler et considérer que la prise de conscience contribue à la cristallisation d’un état comportemental ?
Il est possible que certains phénomènes quantiques tels l’effet tunnel ou l’intrication quantique se retrouvent dans le cerveau humain.
En mécanique quantique, une particule peut passer à travers une barrière énergétique qu’elle ne devrait normalement pas franchir. Ce phénomène est connu sous le nom d’effet tunnel. Cela est rendu possible par le principe de superposition des états et la nature ondulatoire des particules, indépendamment du fait que le cerveau agit telle une antenne qui transforme en ondes les courants générés dans le cerveau et que l’on peut interpréter au moyen d’un électroencéphalographe. Serait-il possible que des signaux générés dans le cerveau se déplacent de manière similaire, échappant aux chemins « classiques » et sous forme ondulatoire à l’intérieur et en dehors du cerveau ?
L’intrication quantique montre que deux particules (ou groupes de particules ou même des molécules) forment un système « soudé » quelle que soit la distance qui les sépare. Les expériences d’Alain Aspect ont confirmé que la mesure d’un état effectuée sur une particule détermine instantanément l’état de l’autre, sans transfert d’information classique. Cette corrélation non locale pourrait-elle suggérer l’existence de formes de traitement dans le cerveau qui dépassent les connexions synaptiques ordinaires ?
Vers un superorganisme technologique
Les progrès technologiques ont été continus au cours de l’histoire et ont changé parallèlement le mode de vie : de la grotte aux métropoles modernes, de la découverte du feu à l’énergie thermonucléaire, de l’arc et des flèches aux missiles balistiques, de la machine à vapeur à l’industrie pétrochimique, de la découverte de l’électricité à l’automatisation électronique, de la société informatisée au télétravail. L’humanité a appris à dompter la nature, à faire fructifier les richesses de la terre, industrialiser ses produits et organiser leur distribution. Le contact entre l’homme, les denrées, les produits manufacturés et la société a été direct. Cela est de moins en moins le cas. L’ubiquité des communications modernes en fait un intermédiaire immanquable, mais aussi un agent de métamorphose radicale de la société contemporaine.
Il est indéniable que nous nous orientons vers une nouvelle ère civilisationnelle.
Les communications modernes sont désormais omniprésentes, envahissant notre quotidien : le téléphone intelligent accapare l’attention des usagers et semble être devenu une prolongation de la main, sinon du cerveau. L’Internet des objets (IoT) permet à d’innombrables dispositifs résidentiels et industriels de dialoguer avec le réseau mondial. Ce réseau agit comme un cerveau collectif, alimenté par des milliards de messages qui le traversent. Nous assistons ainsi à l’émergence d’un superorganisme planétaire capable de capter, traiter, stocker, transmettre, et même générer ses propres idées. Et pourquoi pas ? Pourvoir aux besoins de l’humanité en gérant le monde végétal ou animal et en contrôlant les virus.
Nous entrons dans une nouvelle époque : celle d’un superorganisme technologique global.
L’automatisation se développe dans des directions d’autonomie grandissante. Il n’en reste pas moins que les machines qui développent des capacités de traitement et de mémorisation de plus en plus accrues ne peuvent émuler l’intelligence humaine, car l’IA ne fait qu’imiter le comportement humain. L’IA s’appuie sur la redondance des mots et des concepts pour apprendre et générer ses réponses. Notre dépendance croissante à ses services soulève une inquiétude : à force de produire des réponses à partir d’autres réponses, l’IA pourrait inclure ses propres réponses dans sa base de données et pourrait finir par établir un langage homogène et une pensée uniformisée. En outre, le fait que l’IA peut reconnaître des émotions humaines et simuler des réponses emphatiques ou même émuler l’intuition humaine suscite la crainte qu’elle influence la dimension affective humaine et modifie les dynamiques relationnelles.
Plus que jamais, il semble que la science est de plus en plus en mesure de contrôler la société et non l’inverse. Elle le sera de plus en plus, car l’IoT qui fait communiquer tous les objets qui nous entourent et les fait interagir sans intervention humaine est en train de changer le mode de perception de nos sens et la conscience de leur présence. L’intégration des unités de traitement quantique devra donner l’impression de vivre dans un monde télépathique dans lequel les machines devinent les besoins de tout un chacun. L’être humain sera tel un objet qui s’intègrera dans le réseau IoT qui deviendra un réseau IoT social, redéfinissant ainsi les relations interpersonnelles. Tout porte à penser que l’IoT global va s’imposer dans la vie quotidienne et l’on aura l’impression de domestiquer ses facultés.
À moins que ce ne soit le contraire.
Les premiers essais d’implantation de puce cérébrale dans le cerveau permettent la commande à distance. Nul doute qu’il sera possible d’incorporer l’être humain dans l’engrenage du réseau IoT social. La conscience des êtres et des choses ne sera bientôt plus celle que nous connaissons. Elle sera pondérée par l’autonomie de l’IoT social.
D’une certaine manière, l’humanité elle-même fonctionne comme un superorganisme : chacun y agit, interagit, sans forcément saisir la portée de ses gestes. L’image de la fourmi, ignorante de l’ensemble des galeries de sa fourmilière, ou celle des milliards de cellules qui composent un corps humain, illustre bien cette dynamique collective, complexe et souvent inconsciente.
Vers une super conscience ?
Les consciences de tout un chacun sont synchronisées en ce sens qu’elles s’accordent sur l’identification de certaines perceptions de la réalité. Existe-t-il une conscience universelle qui transcende les consciences individuelles ?
Les expériences de laboratoire ont montré qu’il est possible d’intriquer non seulement des particules élémentaires comme les photons ou les électrons, mais aussi des systèmes plus complexes tels que des atomes et même des molécules. Grâce à des environnements ultra-contrôlés, les chercheurs ont pu maintenir des états quantiques intriqués entre ces entités, démontrant des corrélations instantanées à distance. Il est fort possible que dans le futur, un super cerveau technologique puisse offrir des services « intriqués » aux individus et évoluer vers la téléportation. Qu’en sera-t-il de la conscience ?
Selon le neurobiologiste Dirk K.F. Meijer, tout phénomène se décline selon trois dimensions fondamentales : la matière, l’énergie, et l’information — cette dernière structurant et modulant les deux premières. À l’image du trou noir qui intègre dans son horizon des événements toute l’information qui lui parvient, Meijer suggère que le cerveau est influencé non seulement par les signaux internes, mais aussi par des flux d’information externes, voire par des échanges issus d’une intrication quantique d’ordre cosmique.
Autrement dit, la conscience dépasserait ce que le corps humain produit intrinsèquement : elle émergerait d’une interaction entre l’individu et un champ informationnel universel, reliant l’esprit au cosmos.
Cette perspective trouve un écho chez le philosophe australien David Chalmers, qui affirme : « Les progrès impressionnants des sciences physiques et cognitives n’ont pas permis de comprendre pourquoi les fonctions cognitives s’accompagnent d’expériences subjectives… Il semble bien que la conscience ne puisse être décrite qu’en recourant à des concepts qui font eux-mêmes appel à l’idée de conscience. »
Les rouages de la conscience humaine sont mal compris. La conscience artificielle n’est pas envisageable.
Pas encore…
Les phénomènes d’intrication quantique, envisagés à l’échelle individuelle, sociale et cosmique, ouvrent la voie à des hypothèses audacieuses.
Pourra-t-on envisager un jour un super ordinateur doté de conscience ? Envisager la thèse d’une super conscience future qui serait réseautée à l’ensemble des consciences ? Cette supraconscience pourrait-elle connaître les actions et les pensées de tout un chacun ?
Existe-t-elle déjà ?